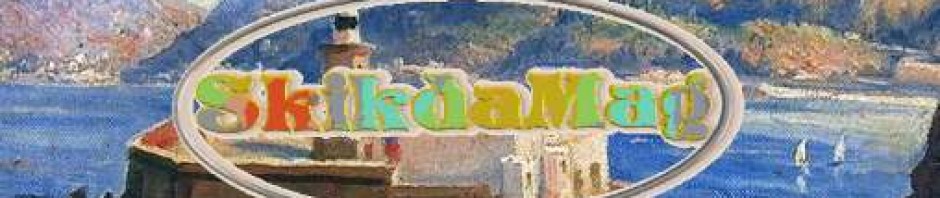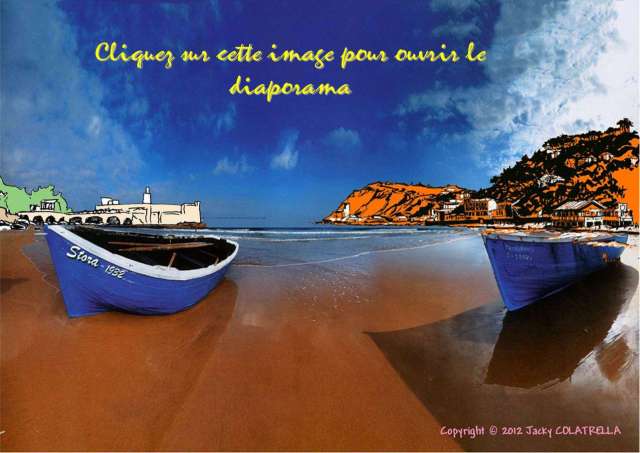Le mot du Webmaster
Toutes les belles histoires commencent par : < Il était une fois …>.
La copie d’AMOR MOUAS est terminée! Il s’agit d’une évocation, un vécu antérieur vivace enfoui très loin au fond de sa mémoire qui n’attendait qu’à remonter à la surface. C’est beau, émouvant et rempli d’espoir. Internet lui aura permis de retrouver des camarades de classe dont ELYETTE ainsi que son instituteur, CLAUDE.
Nous sommes persuadé que les Auribeaudoises et les Auribeaudois chez qui ce message abordera auront chaud au cœur comme ça a été le cas pour Amor en l’écrivant.
Je vous souhaite une excellente lecture.
A plus tard. SkikdaMag (Jacky Colatrella)


Photo de M et Mme POFILET, de mon Père Charles, de mon jeune frère et moi même
et du Ferguson évoqué dans l’article, lors d’une pêche aux aloses avec un carrelet, dont on voit les perches en bois sur l’auto.
Guy Godard
Il était une fois AURIBEAU, un petit hameau d’environ 150 âmes, a équidistance de PHILLIPEVILLE et BONE, longé sur sa face Est par la Nationale qui mène vers la «Coquette ».
Lorsque j’étais écolier, la rentrée des classes coïncidait presque avec les premiers labours d’octobre ; je m’arrêtais alors souvent sur le chemin de l’école pour regarder la cohorte des tracteurs s’élancer avec rage dans un ronronnement continu dans toutes les directions, pour se perdre là-bas derrière l’horizon des collines et des plantations. Je m’amusais alors à ânonner les noms peints sur les capots ; il y avait l’ incontournable « Ferguson » une bête à tout faire , le John- Deer guère plus puissant ,et une vieille et bizarre machine à cylindre unique, énorme, saillant comme une cheminée de train à vapeur au bruit pétaradant , le « FARMAL » ; ceci pour les tracteurs sur pneumatiques. Les chenillards quant à eux se nommaient : Caterpillard (D2, D4, D6 et la montagne d’acier, le monstrueux D8) et une machine tout aussi bizarre, le « MARCHAL » à qui le mécanicien introduisait dans un orifice de son flanc une sorte de cigare qu’elle « fumait » pour démarrer le moteur. En fait avec le recul, il s’agissait de l’ancêtre de la bougie de préchauffage du mélange air- carburant Dans ce tintamarre matinal et l’odeur âcre des rejets gazeux, les monstres s’élançaient à travers la campagne environnante à l’assaut des champs et des plantations que durant des semaines et des mois, ils saignaient, retournaient, sarclaient à l’aide de lourds attelages de charrues à socles réversibles, de charrues à disques, de coover-coop , de brise- mottes , de herses, dans un va- et- vient continuel ; ils préparaient en somme le lit de la semence et de la moisson future, suivis dans leur course effrénée par des hordes d’oiseaux , les pique- bœufs , les bergeronnettes , parfois des vanneaux et même une ou deux cigognes retardataires qui semblaient avoir oublié le calendrier migratoire , venus chercher leur pitance de graines et de vers dérangés dans leur sommeil dans les flancs de la terre nourricière de toutes les formes de vie…
Plus loin, au pied de la montagne , là où le progrès ne pouvait accéder en raison de l’escarpement du relief , ce sont des attelages de bœufs dociles , patients et tout aussi puissants qui traîneront la charrue , attentifs aux commandements du fellah leur indiquant par « ya » d’ aller à gauche et par » jaa » de tourner à droite ; en cas de paresse due à l’épuisement, le fellah les stimulait légèrement à l’aide d’un long bâton en criant » zele », « ataa » et ces fabuleux colosses s’exécutaient avec nonchalance, le port de tête altier et les naseaux fumants dans la fraîcheur des matins d’automne.
A la fin du jour, les bergers rentraient leurs troupeaux , arrachant une ultime et plaintive complainte à la flûte évoquant leurs peines et la dureté de la vie des gens de campagne, c’était un peu leur « blues »; c’était aussi l’heure où les tracteurs regagnaient haletants le bercail par toutes les issues du village et souvent M. MICHEL le fabuleux mécano de M . BALAY allait au devant d’eux à l’orée du village pour ausculter à l’oreille les tressaillements, les ratés de leur mécanique et décider en expert de ceux qui devaient passer à l’atelier se refaire une santé.
En ce temps là encore AURIBEAU grouillait des mille bruits des artisans occupés à leurs tâches ; c’était le temps où M. Rémy NAVIOUX , l’inénarrable forgeron du village, un personnage jovial , débonnaire, pittoresque , qui ne répugnait pas pousser la causette avec les passants , le premier venu, souvent en Arabe local , il le parlait bien, comme : « el hamdou li lah » , après un copieux repas, ou lorsque le Ramadan tirait à sa fin il lançait aux passants :« Il ne nous reste que trois jours n’est-ce pas ? » et je m’arrêtais souvent pour le voir battre sur l’enclume une pièce chauffée au rouge d’où s’échappait des gerbes d’étincelles, dans un tintement régulier qui résonne encore à mes oreilles. Il était l’incontournable maillon de la chaîne de l’entraide à qui l’on avait recours pour réparer une faux, cercler une roue de charrette ou ferrer les chevaux ; dans un geste double il attisait en même temps le foyer ardent qui rendait les métaux tendres pour leur donner aisément forme.
C’était le temps de la diligence , et chaque famille possédait sa charrette , son mulet ou son cheval pour la traîner remplie de grains destinés aux semailles ; elle servait aussi de moyen de locomotion vers les champs comme le faisait M. BONNELO avec un carrosse fait uniquement pour le transport des personnes , qui lui servait à se rendre à sa propriété vers la route de LANNOY ; ce joli carrosse comportait un siège en bois à deux ou trois places, le frein était commandé par une petite manivelle placée à hauteur de la main droite du conducteur qui en la tournant, permettait de diminuer la course de la tige filetée à la quelle elle était reliée, ce qui avait pour effet de freiner et stopper le véhicule.
M.FILLOZ Raymond possédait lui aussi une carriole tirée par un cheval avec laquelle il se rendait aux champs , parfois accompagné de ses filles Nelly et Elyette, pour, entre autres, ramener de l’herbe destinée à la nourriture de ses chevaux , de sa vache et de son ânesse ; il y transportait également la récolte des feuilles de tabac que ses fidèles ouvriers venaient , chez lui, relier en petits bouquets qu’ils ficelaient sous les yeux admiratifs de ses deux filles ; ces bouquets étaient ensuite mis à sécher , suspendus dans un endroit prévu à cet effet , et lorsque les feuilles étaient sèches, ces mêmes ouvriers venaient les empaqueter dans de la toile de jute , le tout cousu de leurs mains et mis dans un caisson en bois rectangulaire ouvert au dessus et en dessous, avec des poignets sur les côtés qui permettaient de soulever , une fois la forme bien prise , le moule qui allait donner les balles de tabacs prêtes à être acheminées à la Tabacoop de Bône pour y être vendues. Le transport jusqu’à cette ville était fait au moyen de charrettes, de ces lourds chariots à quatre roues tirés par des chevaux ou des bœufs ; quelquefois, un camion de Jemmapes ayant appartenu semble-t-il à M.SAHNOUN passait également faire le ramassage des balles pour les convoyer vers la même destination.
En ce temps là, les moyens de transport moderne avaient épargné AURIBEAU, jusqu’à la fin des années 40, où les premiers véhicules utilitaires et particuliers sont apparus.
De mémoire d’anciens Auribeaudois, comme mon Oncle qui est de 36, et autant qu’il m’en souvienne, le premier camion avait appartenu à M. AMIOUR, l’associé de M. BOUDELAA propriétaire de l’épicerie – boulangerie du village. C’était un camion de marque allemande certainement rescapé de la 2ème guerre mondiale que son propriétaire louait, avec chauffeur, pour le transport public de marchandises. Ensuite ce fut M. René VAUDET qui posséda un camion Renault à benne et ridelles avec lequel il transportait son raisin récolté dans son vignoble au moment des vendanges et l’acheminait vers la cave coopérative pour le pressage. Puis l’effet boule de neige s’est installé et ce fut autour de M. MIZZI de posséder un camion pour le transport de tout ce qui a trait aux travaux des champs. Paradoxalement (?) les premiers véhicules particuliers avaient appartenu à des Musulmans ; les premiers d’entre eux furent ; M. BOUKACHABIA Med Salah , qui au retour de l’armée ,( il avait fait la seconde guerre mondiale,) avait possédé une CHAMBORD qu’il utilisait comme taxi , M. BELAHCINI Madjid , encore en vie et en bonne santé, avait possédé une voiture de tourisme à la coque en bois fabriquée à JEMMAPES par le renommé carrossier M. CORBEAU . Ce fut au tour d’un oncle de ma mère, Aïssa AYACHE, qui exploitait l’épicerie à l’angle supérieur de la cour de l’Ecole en face de la maison de M. BALLET, et dont le père était propriétaire terrien, d’acquérir deux voitures l’une après l’autre dans le même style en bois que la précédente. Après ces drôles de limousines en matériaux hétéroclites, est venu le temps des voitures de légende. Paradoxalement encore ; ce sont des Musulmans qui les premiers en ont possédé ; l’oncle de ma mère avait une Peugeot 202 , qu’il faisait démarrer à la manivelle devant notre école où il aimait la garer à l’ombre du maintenant vieux frêne ; M. MANSOURI Amor avait lui des » Citroën » , la 11 légère puis la 15, qu’il utilisait comme taxis ; puis ce fut au tour des P.N. d’en acheter et ce serait M. POFILET , avec sa Simca P60 bleue -grise , une Etoile six, qui aurait inauguré le cycle qui mènera à la banalisation de ce moyen de transport moderne à AURIBEAU. Apparemment ensuite , dans les années 50 ce furent les Renault Juva 4 de MM. Aimé BALLET et François SPITERRI qui ont fait leur apparition aux côtés d’autres voitures de plus en plus performantes, aux lignes recherchées, comme une Dauphine rouge, ayant appartenu à Charly INGLESE , semble -t-il, les 403 de MM BALAY , ORTS et B0NTOUX sans oublier M. STEFANINI, notre Instituteur qui était arrivé en 59 ; lui aussi avait sa Peugeot 403, une limousine qui faisait rêver et que les Algériens ont définitivement adoptée en raison de sa sobriété et de son endurance, soit pour un usage familial , soit pour servir de taxi permettant aux habitants locaux de rejoindre les villes et villages environnants , ce qui était bien pratique pour les urgences en tous genres ou tout simplement pour passer une journée de détente à JEMMAPES lors des journées de festivités que la ville organisait .
C’était le temps de nos jeux à l’heure de la récréation , dans la cour sous les acacias , encore présents, et autour de l’énorme mûrier , qui hélas atteint de maladie s’est effondré il y a quelques années; sous le préau par temps pluvieux , nous rivalisions à grimper à la corde à nœuds suspendue au plafond, sans l’aide des pieds , uniquement à la force musculaire des bras ; une performance qui n’était pas à la portée de tous et que seul , devant nos yeux écarquillés, M. MALDENT notre Instituteur, avait réussie , les jambes tendues en équerre avec ça!
C’était le temps où le marché Arabe hebdomadaire se tenait le jeudi dans un spectacle bigarré et un brouhaha ininterrompu avec sa cohorte de marchands de bestiaux de volailles, d’œufs , de friperies , d’épices ,de semoule, d’orge , et toutes sortes d’animaux ; des ânes pour leur utilité dans les travaux domestiques , recherchés par les foyers modestes pour qui ces doux compagnons ramenaient les fagots de bois , les jarres d’eau, et transportaient les sacs de blé et d’orge au moulin à grains de M. BORG père , ou celui plus bas de M. René VAUDET . On y rencontrait aussi le commerce des chèvres, -rarement les bovins et les ovins,- car les premiers d’entre ces animaux étaient peu exigeants, ils savaient se » débrouiller « presque seuls pour trouver à se nourrir même en grimpant sur les oliviers ou en escaladant les pentes escarpées. C’est un bel animal rustique d’une vivacité déconcertante toujours en éveil , facile d’entretien, arborant une robe toujours propre à deux tons , noir et blanc ou marron et blanc , avec une jolie petite tête surmontée de cornes effilées, chevrotant des « Mêêê » pour rallier leurs petits par trop téméraires s’aventurant loin du troupeau ; sans oublier le plus remarquable et leur plus gracieux attribut : la BARBICHETTE .
Ce jour de marché était aussi le rendez-vous des marchands de confiseries , la Zlabia dégoulinant de miel avec tout autour des nuées d’abeilles , le Nougat clairsemé de cacahuètes , des sucreries en forme de serpent lové sur lui- même , striées de rouge, de jaune ou de vert, que le marchand découpait aux ciseaux en portions pour les vendre . Au milieu de la place , la fumée et la senteur qui s’échappaient à travers les eucalyptus trahissaient la présence du marchand de brochettes et de merguez grésillantes sur le feux de bois, dont raffolait Charly INGLESE , un aîné avec qui on partait à la chasse aux étourneaux se gavant dans les oliviers bordant le chemin menant aux vergers derrière la maison de M. Lollo LAVERRIERE , avec une belle carabine à air comprimé ( une DIANE ), et aux pigeons , (cette fois avec un vrai fusil ,) qu’il interceptait le soir à leur retour au nid après une journée passée dans les champs à la recherche de nourriture.
C’était le temps où, lorsque la froidure s’installait et que les frimas de l’hiver givraient nos mains et nos oreilles, notre classe était chauffée par un poêle que chacun de nous, à tour de rôle , allumait le matin avant l’arrivée des élèves ; et si le bois manquait il fallait aller chercher les bûches dans la réserve située dans la cave sous la classe accessible par quelques marches en planche ; un lieu obscur , éclairé par trois ou quatre lucarnes d’où filtrait un rai de lumière, où le moindre crissement d’un objet dérangé, un rat qui détalait dans l’obscurité nous faisaient tressaillir.
C’était le temps des crues de l’Oued Hamimine descendu des thermes du même nom surgis au pied de plusieurs collines à un quart d’heure de bicyclette du village , et de l’Oued Mechekal dont les furies de 1957 ont submergé l’orangeraie de M. BALLET. (Le niveau de la crue a été gravé sur le mur de sa cave au bord de la Nationale menant à Bône.)
Beaucoup de personnes allaient à cette occasion « voler » aux flots, à l’aide d’une épuisette fixée au bout d’un long roseau, les oranges flottant sur l’eau ; ils en ramenaient des pleins sacs de jute pour le plus grand plaisir des enfants.
J’ai souvenance, en cette année là, qu’un jeune soldat du contingent a laissé sa vie, emporté par les flots, lorsque le conducteur du GMC qui transportait sa section, mésestimant le danger, avait tenté de traverser le courant trop violent.
En ce temps là, AURIBEAU connaissait trois cultures principales : les agrumes, la vigne et la culture céréalière. Les cultures maraîchères étaient circonscrites à quelques modestes espaces cultivés en légumes ; navets, carottes, poivrons, courgettes quelques parcelles de pastèques et melons ; elles étaient surtout destinées à l’autosuffisance de la population locale et des villages voisins.
Les autres variétés fruitières étaient représentées par quelques rangées de figuiers ayant appartenu à M.VAUDET, après le pont qui enjambe l’Oued MECHAKEL, les pêchers de M. Lollo LAVERRIERE en contrebas de sa maison, proche de sa vigne au bord de l’Oued Hamimine.
La culture du tabac était aussi sporadique, que ne pratiquait que M. BALAY pour le compte des domaines LATRILLE et de M.M Henri DONIAT et FILLOZ Raymond.
En ce temps là, les orangeraies, avides d’eau, déroulaient des bandes vertes au gré des méandres des cours d’eaux qui arrosaient notre petite vallée.
Plusieurs variétés des plus connues et des plus recherchées étaient cultivées en ces lieux propices, riches en alluvions, en eau, et de ce soleil du Pays qui favorisaient l’éclosion des fleurs et le mûrissement des fruits, encore verts tout l’été.
A partir d’octobre commençait la cueillette de la reine des agrumes, la CLEMENTINE, fille de ce pays où elle avait été conçue par l’Abbé CLEMENT à MISSERGHIN, du côté d’ORAN, en 1894, en croisant les fleurs du bigaradier et celles du mandarinier. C’est à l’orangeraie de M.LAVERRIERE en contrebas de la cave à vin, que croissait dans un petit carré, ce fabuleux fruit à l’écorce facile à décoller et dont les quartiers sucrés et parfumés se détachaient aisément les uns des autres. Arrivait ensuite à maturité la Mandarine , au goût légèrement acidulé et à la peau boursouflée qui étaient tout aussi exquise que cultivaient MM. POFILET et BALLET , entre autres, en contre bas de la maison cantonnière derrière une haie de pins brise-vent qui continue encore de nos jours à remplir son rôle de protecteur comme un sacerdoce. Ces primeurs étaient suivis des autres variétés : la double fine, la sanguine très appréciée par nous les enfants pour la couleur rouge sang de sa pulpe et l’abondance de son jus qui étanchait notre soif au détours d’un sentier lorsque l’eau potable n’était pas à portée de la main , la Java et la Maltaise aussi juteuses , au goût acidulé, à la pulpe veinée de stries rouges ; ces variétés étaient cultivées un peu par tout le monde certainement en raison des rendements élevés qu’elles donnaient
La fin de la cueillette était marquée par la variété la plus noble d’entre toutes, la Thomson, à la pulpe veloutée et parfumée ; elle était destinée entièrement à l’exportation. Les mamans de nos camarades de classe en faisaient de délicates confitures et marmelades en intégrant l’écorce qui leur donnait un arrière goût légèrement amer malgré la présence en grande quantité de sucre.
C’était le temps où le four à pain du village, au fond de la boulangerie enchâssée entre la maison de M. Henri DONIAT et la brasserie de Mme et M. DONIAT, répandait l’odeur du levain et du pain chaud dont nous achetions juste un quart ou ce petit pain si menu et si mignon que l’on tapissait d’une portion de fromage , »la vache qui rit »,ou accompagné d’une grosse barre de chocolat noir , dont je garde dans mon palais le goût et l’odeur unique comme la madeleine de tante LEONIE que PROUST n’a jamais oubliée…
C’était le temps où bon nombre d’entre nous allaient à l’école pour la première fois à la rencontre de nos vénérés Maîtres sans l’œuvre de qui ces lignes n’auraient pas été…
Nous gardons tous, parents et élèves, un tendre et affectueux souvenir de ces Idoles, enfants du Pays, comme M. Claude STEFANINI, natif de PHILLIPEVILLE le Directeur de notre École et en charge des classes d’examen ; il a conduit la plupart d’entre nous au Certif. et aux différents examens d’accès à la 6e et au C.N.E.T. ; avant lui M. REFALO venu d’El Arrouch était également notre Directeur , et dispensait les cours aux classes inférieures ; d’ autres venus de loin comme M. Lucien MALDENT originaire du CREUSOT , mon second maître au début des années 50 , après M. SECRETO ; M. François SAVIO venu d’AGEN une ville sur la Garonne qu’il évoquait souvent pour célébrer la réputation des pruneaux de son LOT -ET- GARONNE natal; et bien d’autres encore, pour ne citer que ceux qui ont modelé de leur empreinte nos jeunes cerveaux et marqué de façon indélébile la société à l’entour par l’animation qu’ils ont su créer autour d’eux. Ils sont les illustres compatriotes qui ont permis l’émergence des futurs cadres de l’Algérie d’après 1962 ; c’est ainsi que l’année scolaire 1962-63 avait connu pas moins de trois enseignants natifs du village, des employés à la Mairie et une multitude d’élèves partis à la conquête du Savoir dans les Lycées et Collèges plus tard aux Universités qui ont donné à Auribeau des Ingénieurs ,(certains sont hauts cadres d’ Entreprises) , des professeurs , des Juristes, des Médecins et même des Enseignants Chercheurs ; c’est dire que la graine semée était de bonne qualité ; elle a essaimé à son tour pour donner une Pléiade d’élites locales dont les compétences sont appréciées et dépassent le cadre régional , certaines ont même un destin National. C’est là l’œuvre de nos Maîtres dont l’unique préoccupation était la dispense du savoir, ce qui les rapproche des Saints et mérite à ce titre notre vénération ; il est alors venu le temps où ils sont en droit de recueillir reconnaissance et honneur pour leur travail acharné et ce serait sacrilège, inexpiable, que de les oublier. Ils trônent pour l’éternité en une place à part dans nos cœurs et nos mémoires.
C’était le temps où nos Maîtres consacraient, en plus de leur labeur d’éducateur , leur temps libre à des activités extra-scolaires valorisantes , dont la dispense de cours du soir pour adultes, l’introduction du sport et la tenue de festivités grandioses marquant la fin de l’année scolaire; comme ce fut les lendits de 1960 , les inoubliables courses aux oripeaux, la course des grenouilles , celle des baudets … devant un parterre de personnalités dont l’autorité Académique ; à cette occasion beaucoup de médailles avaient été décernées aux meilleurs d’entre nous.
A ces Maîtres émérites , M. Claude STEFANINI , M. Lucien MALDENT un éducateur au grand cœur qui avait les yeux humides et rougis lors des séparations en fin d’année scolaire, M.SAVIO l’initiateur des lendits et organisateur des sports à la campagne ( le cross , le football , le volley-ball ) va notre reconnaissance et nous nous inclinons humblement devant tant de générosité et de sacrifices .
C’était le temps où, dès les premiers jours de printemps, en Mars, nos jeux étaient transportés sur la » Place aux frênes « , ainsi baptisée par Elyette et moi à l’occasion de nos retrouvailles, située en face de sa maison : c’était un espace tapissé d’herbe, où croissaient les pâquerettes et surtout les NARCISSES de notre enfance enchantée, oui des narcisses qui poussaient au milieu du village ! tellement la nature était préservée… dont on faisait des bouquets odorants que chacun ramenait chez lui. La Place aux frênes était le lieu ombragé de nos jeux : le jeu de « touche » celui de » l’avantage » avec une pelote en caoutchouc bariolée ou une balle de tennis, et là l’espiègle Elyette et Arlette BORG, qui habitait plus haut que chez elle, nous rejoignaient parfois, pour partager furtivement ces jeux de « garçons ».
Ce temps là , le début de printemps annonçait le renouveau et notre communauté le fêtait un peu comme le nouvel An , une coutume venue de la nuit des temps, elle serait d’origine berbère : ces peuples anciens d’agriculteurs et d’éleveurs saluaient par des offrandes et des festivités les richesses que cette saison annonçait .A cette occasion nos mères nous préparaient des galettes rondes enduites de jaune d’œuf qui les rendaient dorées et des galettes à rebord dentelé que nous roulions sur l’ herbe de la Place aux frênes et à l’entour de nos demeures avant de rejoindre nos foyers pour déguster ces fameux gâteaux en forme de losange , » Lebraj » faits de semoule liée avec du beurre et de l’huile , fourrés de dattes écrasées , cuits sur le « Tajine » en terre accompagnés de petit-lait. A l’ occasion de cette fête qui pouvait durer plusieurs jours , certains foyers préparaient ces crêpes succulentes « Lemchehda « de forme ronde criblées de petits trous et de cloques qu’on avalait goulûment tapissées de miel ou de sucre et de beurre. Souvent des camarades comme Jean –Louis – LEGER venaient à cette occasion dans nos demeures pour partager notre joie et les délices des jours de fêtes.
C’était le temps de nos jeux, partagés avec des camarades tels Jean- Claude MICHEL sur le seuil de sa maison, où l’on s’amusait à monter des Mécano. qu’il avait reçus en cadeaux pour NOËL, ou avec J.L. LEGER lors de randonnées avec la Jeep Américaine qu’il empruntait à son père pendant ses heures de repos au temps où il était forgeron à la ferme de M. TRAPPE , ou encore Jean-Marc LAVERRIERE cet agréable camarade de jeux qui aimait partager avec nous ses goûters , du pain beurré et sucré ou une barre de chocolat …
Lorsque le printemps tirait à sa fin et que les chaleurs s’installaient doucement , venait le temps où, jeunes écoliers, on assistait à la belle saison, au spectacle du jeu de boules en face du relais » ALESTRA » près de la fontaine publique où les bêtes venaient se désaltérer dans l’abreuvoir qui leur était destiné , ou bien sur la place au centre du village; agglutinés silencieusement autour du rectangle clôturé de petits piquets reliés par une mince corde où un gros fil , retenant notre souffle en communion avec les joueurs, dans l’attente de voir une boule éliminée dans un bruit sec et un jet de poussière.
Puis l’ été venant , la cueillette des oranges et la récolte des maraîchages achevées, il fallait quitter le lit fécond longeant les cours d’eau pour aller vers les coteaux avoisinants ou plus loin encore en empruntant le chemin vicinal qui menait à Oued Zeher et Aïn Bekkouche, la source qui alimentait en eau AURIBEAU, où les Romains avaient apparemment installé un camps militaire avancé , comme en témoignent des blocs de pierre taillée ,visibles encore de nos jours dans l’enceinte d’un cimetière musulman local , « El Zarouria » , qui tire son nom de la présence de quelques arbrisseaux épineux , de la même famille que l’aubépine, donnant des pommettes grosses comme une noisette au goût acidulé que nous ramassions en été . L’aubépine voisine, elle, donnait de petites baies rouges tout aussi comestibles que nos grand-mères administraient aux personnes souffrant de troubles digestifs. De part et d’autre de ce chemin s’étendaient deux vignobles des domaines LATRILLE dont M. BALAY était gérant. Ces vignes très exposées au soleil donnaient principalement la variété « Sinsault » destinée à être pressée, mais qui était aussi prisée dans nos foyers pour son goût très sucré et sa pulpe molle donnant d’excellentes confitures onctueuses avec lesquelles l’on tapissait des morceaux de galette pour le goûter
En aval, le long du petit ruisseau qu’alimentait la source de Bekkouche et les ruisseaux et ornières descendus des collines, croissait une petite bande de vignoble de cinq ou six hectares ayant appartenu a M. FILLOZ Raymond, le père d’Elyette et Nelly , toutes deux camarades de classe des années cinquante ; je garde un souvenir vivace de ce lieu , où à la lisière de la propriété, un coin ombragé par un grand frêne très feuillu en été servait à protéger des rayons du soleil les vendangeurs au moment où ils s’arrêtaient pour prendre leur déjeuner , et où et était mis à l’abri des chaleurs le baril d’eau potable . Un chemin de terre battue carrossable menait à cette propriété, à l’usage des riverains et qu’empruntaient aussi les attelages de chevaux de M. Raymond FILLOZ tirant les lourds tombereaux pleins de raisins vers la cave à vin
Ce qui m’est resté le plus de ce lieu proche du frêne, c’est que là croissaient quelques ceps de ces fameux » Chasselas », une variété précoce de raisin aux petits grains dorés, presque translucides, oh ! combien exquis ! destinée à la consommation domestique Lors des vendanges , petit enfant , je rejoignais mon grand- père et mes oncles qui travaillaient non loin de la maison dans un champs de tabac , séparé du vignoble par le chemin de terre battue; pour les rejoindre j ‘avais à traverser la route nationale pour accéder au talus séparant les deux propriétés. J’attendais midi, l’heure de repos sous le frêne, que rejoignaient également les vendangeurs; certains d’entre eux rapportaient dans leurs chapeaux de paille quelques grappes de ce fameux raisin, qu’ils partageaient avec nous ; en ce temps là tout était mis en commun, chacun ramenait quelque chose à manger, qui du petit lait et l’incontournable galette, qui un ragoût de pommes de terre, des haricots, ou encore de la sardine en boite, des olives et du fromage en portion… Cette ripaille était partagée et tout le monde pouvait prendre ainsi un repas « varié», un réflexe d’entraide inconsciente qui ne se disait pas, une règle sociale qui débordait jusque dans le détail d’un déjeuner de vendangeur.
Mon oncle ZAGHDOUD que je suivais partout où il travaillait, fut employé par M. FILLOZ jusqu’en décembre 62 à la cave à vin en face de la gare, date à laquelle M. RAYMOND avait rejoint sa famille en France ; et là encore le destin et les hasards de la vie les avaient fait se rencontrer, cette fois ci à DRAGUIGNAN vers 1965 où M. FILLOZ était employé dans une cave réputée pour son excellent vin vendu de par le monde se reconnaissant sous le nom de Ste ROSELINE dont le propriétaire n’était autre que le Baron De RASQUE De LAVAL , aujourd’hui disparu. A présent la propriété continue à être gérée par ses descendants. M.FILLOZ aurait donc, sans hésiter, proposé à mon oncle de le présenter à son employeur en vue d’ une embauche, mais il ne pouvait le faire, à regret me confia-t-il, car il était employé aux chantiers navals de la CIOTAT …
De cette famille humble, laborieuse, affable et discrète, je garde moi-même, ainsi que tous les anciens AURIBEAUDOIS, un tendre et affectueux souvenir. Récemment , grâce à la magie de l’Internet j’ai pu renouer le contact avec Elyette, la fille de M. RAYMOND, une camarade de classe , proche de nous à l’école où elle participait avec nous aux activités sportives dans lesquelles elle excellait : championne de sa classe au saut en hauteur , médaille à feuilles de laurier gagnée à PHILLIPPEVILLE en 1960 pour avoir décroché le premier prix de la course à pied ( excusez du peu !) organisée grâce à M. STEFANINI notre Directeur d’école. Dans les activité culturelles où à l’occasion des lendits de 1960, elle avait tenu le rôle de SOPHIE dans la pièce de Mme de SEVIGNE jouée à la salle des Fêtes du village.
Désormais la saison chaude avançait, les travaux des champs devenaient plus rudes avec ce soleil qui dardait ses rayons à la verticale, mûrissant toute culture ; c’était le moment où la récolte du tabac commençait, les moissons battaient leur plein et le battage du blé se préparait …
Cette bande de terre, voisine du vignoble de M. Raymond FILLOZ ayant appartenu à M. Henri DONIAT, non loin des maisons de mes parents , grands-parents, oncles, et tantes , dans notre « DACHRA « comme je l’ai déjà narré, était cultivée en tabac, et c’est cette proximité , certainement, qui faisait que les travaux de cette culture étaient concédés par le propriétaire à mon grand-père aidé de mes trois oncles .
En ce temps là, en été, l’école était finie, c’était la période des grandes vacances et je n’étais pas très loin de mes oncles et mon grand-père que j’accompagnais partout dans leur labeur quotidien; je m’amusais alors à me faufiler entre les plants de tabacs qui me dépassaient en hauteur, là je construisais un monde à moi : le bousier roulant perpétuellement son » fardeau de Sysiphe » devant lui devenait , par la déformation de mon imagination infantile un monstre à tête cornue; la découverte d’une mante religieuse, c’était la méchante fée des contes ;la toile tendue par l’araignée entre deux plants de tabac ressemblait à un piège qui allait m’engloutir :à la vue de la rangée d’ yeux de cette créature impassible attendant ses victimes j’avais des frissons de peur ; c’était un univers à moi peuplé de lutins sortis des contes populaires que nous racontait jadis « tante SARHOUDA « l’épouse de mon oncle AMAR ,( ils vivent depuis 1962 à SUIPPES dans la MARNE) durant les nuits d’hiver autour d’un brasero rendant une lumière rougeâtre propice aux fantasmes Ce fut un monde à moi où je dialoguais à voix basse avec mes « fantômes » , un monde merveilleux où je me transportais l’espace d’une rêverie , assis à l’ombre des feuilles de tabacs ; un bonheur long comme une éternité , interrompu par l’appel de mon grand-père, m’ayant perdu de vue, et qui me ramenait contrarié à la réalité…
Lorsque les plants de tabac, en plein été, arrivaient à maturité, la récolte des feuilles pouvait commencer. Les feuilles de tabac étaient classées en trois catégories : celles du « bas », la moins valeureuse, appelée par nos parents « harfi », celles du milieu » ezzina « (la belle) de moyenne qualité ; les feuilles supérieures » choucha » (la supérieure) représentaient le « must » de la culture tabatière.
En fin de journée la récolte était acheminée vers les hangars où les feuilles devaient sécher au soleil, attachées en grappes par du raphia et suspendues en étage par du fil de fer fixé à l’intérieur d’un cadre métallique porté par un rail horizontal sur lequel il coulissait à l’aide de petites roues de poulie nervurées . Alors enfant je passais mes journées avec mon grand- père et mes oncles à les regarder , dans un rituel immuable, sortir des hangars, le matin, les gabarits mobiles pour les faire sécher au soleil toute la journée , les retourner sur les deux faces pour un séchage uniforme et les rentrer le soir au coucher du soleil pour la nuit.
Ma grand- mère, ma mère et mes tantes n’étaient pas en reste de la corvée puisque le travail le plus fastidieux, l’assemblage des feuilles en petites grappes à l’aide d’une grosse aiguille et de raphia, leur était destiné en exclusivité, la couture étant « l’apanage des femmes »… .Mais cela ne dispensait pas nos adorables, nos vénérables Mamans de participer à la cueillette, l’après-midi, aux côtés des hommes, entre deux travaux ménagers…
C’est le temps venu des moissons : les blés ont blondi au soleil torride, le lâcher de la horde des moissonneuses lieuses aux champs de blé est révélé par les longues bandes régulières qu’elles tracent derrière elles ; les gerbes de blé sont entassées en petits monticules , un tracteur à remorque les achemine vers l’aire de battage en bas du village où se forment les meules de blé dans un alignement précis qui permet l’installation au centre de la fameuse batteuse et du tracteur qui entraîne la grande roue fixée à son flanc . L’aire de battage est limitée au sud par une haie imposante de figuiers de barbarie infranchissable si ce n’est à travers un chemin carrossable de terre battue qui l’interrompait en son milieu permettant l’accès aux vignobles de MM. BALLET et FILLOZ et servait également de raccourci qui conduisait plus loin aux Mechtas environnantes.
C’est le temps, où, arrivé l’été, un autre spectacle s’installe au bas du village sur l’aire de battage, un espace que nous appelions « El comminal » rappelant son appartenance au Domaine Communal que nul ne pouvait s’approprier.
Là sont entassées en imposantes meules les gerbes de blé de chaque propriétaire attendant le grand jour de l’arrivée, comme une comète au retour régulier pour s’éclipser jusqu’à la saison nouvelle, de l’infatigable batteuse rouge sortant de son hibernation dans les hangars situés en haut de l’aire de battage aux cotés des tracteurs que la coopérative agricole louait aux cultivateurs qui n’en possédaient pas.
Le grand jour étant arrivé, c’est dans un ronronnement continu, perceptible de loin, que le tracteur « Ferguson » ou « John- Deer » entraîne, à l’aide d’une longue courroie en bâche ou en cuir, le mécanisme de la batteuse. La cadence imposée par la machine est rythmée par le mouvement coordonné des ouvriers au sol qui balancent à l’aide de fourches les gerbes de blé en haut sur le plateau où elles sont reçues et dirigées par l’engreneur dans la bouche béante qui va les dévorer et les engloutir dans ses entrailles avant que la coulée de graines crépitante n’apparaisse le long d’un plan incliné au bout duquel étaient agrafés des sacs de jute destinés à les transporter vers leur destination finale , les Silos à grains , le marché local ou l’exportation vers la Métropole.
C’était le temps où la saison agricole finissante s’achevait en apothéose avec le spectacle chamarré des vendanges, dans une farandole sans fin de tombereaux, de charrettes, traînées par des bœufs ou des chevaux, de remorques tirées par des tracteurs. Le raisin était acheminé vers la cave coopérative ou celles de MM. SPITERRI et MIZZI pour être pressé. Alors adolescents , nous participions à cet événement saisonnier, dans les vignobles de MM. BALAY, Lollo LAVERRIERE , Aimé BALLET , pour ne citer que ceux-là ; une opportunité qui nous permettait de participer à l’achat d’effets vestimentaires et scolaires en prévision de la rentrée des classes et des rigueurs des hivers ; aux cotés de nos aînés , hommes et femmes , que des remorques amenaient aux vignobles chaque matin avant le lever du soleil, au moment où les ceps de vigne rendaient une odeur un peu âcre due aux traitements chimiques qu’ils avaient reçus contre le mildiou principalement. Les femmes trouvaient, dans cet exutoire, un peu de liberté en s’arrachant à leur ermitage et aux tâches domestiques ; deux ou trois semaines durant elles travaillaient dans les vignes, ce qui représentait un apport non négligeable à la constitution des réserves de nourritures pour la mauvaise saison.
Quant aux enfants que nous étions, les vendanges étaient vécues, comme une fête ; le théâtre de nos jeux était désormais un champ de vigne où nous rivalisions à qui arriverait le premier au bout de la rangée après l’avoir dénudée des lourdes grappes de raisin sentant encore la fraîcheur matinale. Cette compétition effrénée , était encouragée par le Chef du chantier et sous les acclamations des jeunes filles à qui nous voulions , quelque part , prouver notre virilité; c’était le passage obligé de notre entrée dans le monde des adultes ; un statut social supérieur , qui nous conférait désormais des privilèges , notamment celui d’être admis dans les « DEMAA » ; ces réunions de chefs de familles destinées à régir la vie à l’intérieur du groupe familial .Les adultes n’avaient plus de secrets pour nous , en fait , on méritait ces faveurs à l’aune de l’aptitude au travail, et par le travail, la seule valeur qui autorisait l’intégration dans la société pour devenir un jour , précocement parfois , chef de famille à son tour ; car il fallait assurer la pérennité du clan, une fois les Patriarches disparus.
Les vendanges terminées, c’est un ultime spectacle qui s’affichait devant la cave coopérative face à la gare ferroviaire; là surgit, un beau matin, venu on ne sait d’où, une énorme « cocotte » noire pétaradante : c’était l’alambic qui allait extraire l’eau de vie du marc de raisin âpres sa pression… La chaudière bruyante assurait la distillation du marc dont les vapeurs en se condensant à travers le serpentin de l’alambic allaient libérer le fameux breuvage dont les émanations étaient humées de loin. C’est ce cycle agraire qui avait rythmé la vie de notre village où il faisait bon vivre autrefois…
Il était une fois AURIBEAU, un petit village fleuri des bougainvilliers qui embellissaient les clôtures des maisons de MM. BALAY et POFILET , des glycines aux grappes de fleurs mauves odorantes enlaçant les façade des maisons de MM. NAVIOUX et SPITERRI , des géraniums et d’arums dans chaque maison, des rosiers grimpants de la maison de Nelly et Elyette FILLOZ embaumant les ruelles alentour, du mimosa de la maison cantonnière que j’habitais au départ de la famille de M. ROUSSEL, l’employeur de mon père, qui avait emménagé dans la petite Chapelle après le transfert de l’Office à l’Église au centre du village, où, les dimanches et jours de fêtes religieuses, s’activaient de petites processions de fidèles, lors des cérémonies des premiers Sacrements , des baptêmes et des communions , des mariages aussi, reconnaissables à la tenue de la mariée.
Et chaque maison avait dans un coin de jardin, comme pour les préserver, quelques plants de Chrysanthèmes destinés à honorer les morts au jour qui leur était consacré.
A nos Amis d’antan nous disons que leurs Ancêtres et leurs Parents, qui reposent ici sont devenus nos Parents ; nous leur devons le Respect que l’on doit à tous les morts ; qu’ils reposent pour l’éternité dans cette terre qui les a vu naître et qui ils ont tant aimée.
Que ce petit clin d’ oeil à un passé commun riche en évènements, puisse remuer le souvenir de nos camarades d’enfance et les inciter à renouer avec leur passé et leur Pays qui ne les a jamais rejetés.
CE TEXTE A ETE REDIGE PAR ELYETTE FILLOZ et AMOR MOUAS
ENFANTS D’AURIBEAU
Participation de Claude STEFANINI